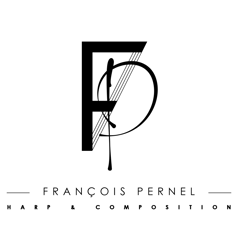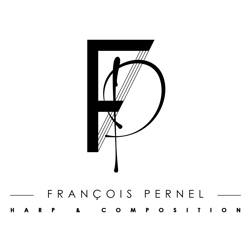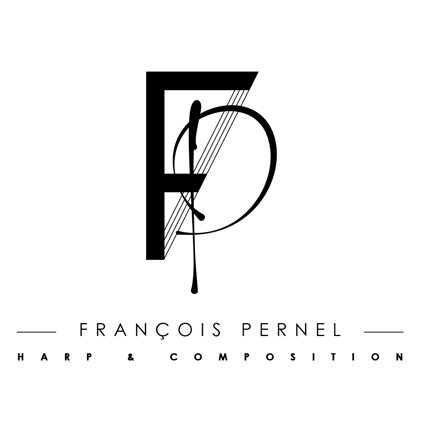MON PARCOURS
Bien que ma formation soit rigoureuse, ayant obtenu une médaille d’or en harpe au conservatoire de Reims, la musique que je propose dans ces recueils s’ancre souvent dans l’intuitif et le spontané. Mes compositions explorent une variété d'exercices rythmiques et de mélodies dépouillées, caractérisées par un minimum d’indications de nuance ou de phrasé.




En matière de composition, ma ligne directrice est que la musique appartient à la simplicité. La simplicité est peut- être l’inverse du simplisme. Le simplisme cherche désespérément à écarter le complexe et à éloigner l’effort. La simplicité cherche au contraire à condenser le sens avec un minimum de moyens, à trouver la ligne d’équilibre, ténue, à partir de laquelle une liberté et une expression du subtil sont possibles. Les grands interprètes savent rendre simples et évidentes à l’écoute les pièces les plus véloces et complexes, les grands compositeurs savent révéler la profondeur à partir de quelques notes seulement.
Avec le temps, on affûte sa palette sonore et on se sépare de l’esbroufe.
Par ailleurs, je n’adhère pas à la tradition musicale qui consiste à se couper de tout héritage – du moins à faire semblant. Nous sommes avant tout le produit de toutes les influences que nous avons reçues. Le naturel n’est que la somme de tous les culturels. Aussi n’ai-je aucun scrupule à m’inspirer ouvertement d’un compositeur, d’un genre, d’un style. Je ne le fais pas d’une manière « intelligente », mais d'une manière empirique, intuitive. Composer est le lieu, selon moi, où la jouissance précède la compréhension. On trouvera donc, dans mes compositions, un hommage à Chopin, un clin d’œil à Messiaen et des ballades qui pourraient directement sortir d’un juke-box des années 80.
J'assume pleinement cette « salad bowl » à l’américaine. La musique à mes yeux n’est pas compartimentée entre la grande musique, les musiques traditionnelles et les musiques de variété. Il y a différentes techniques placées à différents endroits, et le fait d’avoir exploré ces nombreux visages m’interdit aujourd’hui toute forme de hiérarchie.
Il n’en reste pas moins que la plupart de ces pièces sont nées de la pédagogie.
Copier des maîtres me paraît aussi important que faire des gammes. Mais je tiens à préciser un point essentiel : copier Ravel, Debussy ou Satie, ça ne se fait pas uniquement par la compréhension rationnelle de leurs éléments de langage, mais par imprégnation de leur musique et de la liberté qu’elles contiennent. Ce temps d’imprégnation est le même qui est nécessaire pour savoir jouer de la musique traditionnelle irlandaise, bretonne ou même baroque. On peut lire les traités, annoter les partitions au maximum, rien ne saurait remplacer l’imprégnation par l’oreille ou par le corps (pour la danse) ; la partition n’offre toujours qu’un minimum d’informations et le reste du chemin est à trouver sur la manière de placer ensemble deux notes qui s’aiment, comme dirait Mozart.




contact@francoispernel.fr
+33 6 09 80 14 26
© 2025. All rights reserved.
Illustrations
Perrine Cierco
Crédits Photographiques
Lucie RotureaU
Samuel Rames
Logo : Urielle Penn